PROTECT YOUR DNA WITH QUANTUM TECHNOLOGY
Orgo-Life the new way to the future Advertising by AdpathwayAu square Cabot, en plein centre-ville de Montréal, Nakuset observe les techniciens qui terminent l’installation de la scène. Directrice du Foyer pour femmes autochtones, elle supervise le concert organisé avec POP Montréal et Résilience Montréal, un moment festif, mais chargé de sens dans un lieu marqué par l’itinérance autochtone.
En cette Journée nationale des peuples autochtones, Nakuset espère que les personnes en situation d’itinérance — trop souvent invisibles — auront, elles aussi, une place dans les festivités.
Oui, les célébrations du 21 juin sont essentielles. Mais elles devraient aller bien au-delà de l’événementiel. Ce jour-là, c’est de la joie. Et la joie, pour ceux qui vivent dans la rue, c’est rare. C’est pour eux qu’on fait ça, indique-t-elle en entrevue.
Pour Nakuset, cette journée qui correspond au solstice d’été révèle un paradoxe douloureux : célébrer la culture pendant que des Autochtones dorment dans la rue, criminalisés pour leur pauvreté. Partout au pays, on craint des reculs législatifs qui viendraient fragiliser encore davantage nos droits déjà précaires, avertit-elle.
Ces dernières années, elle est d’ailleurs témoin de la transformation, souvent brutale, du square Cabot. Mais selon elle, jamais la situation n’a été aussi critique. C’est pire que tout ce que j’ai vu en 20 ans de travail ici, tranche la directrice.
Depuis la pandémie, tout s’est effondré. Il n’y a pas assez de services, les gens sont à bout.
Afin de tenter de recréer un peu de liens, Nakuset et son équipe ont récemment mis sur pied des ateliers d’animation chaque vendredi, en collaboration avec la Ville de Montréal. Et un nouveau projet est en chantier.
On a demandé du financement sur trois ans pour maintenir nos médiateurs sur place, et embaucher un intervenant jeunesse. Parce que beaucoup de jeunes issus de la DPJ se retrouvent ici, et certains tombent rapidement dans l’exploitation sexuelle. Il faut quelqu’un pour les accrocher, les orienter, avant qu’il ne soit trop tard.

Près de 30 ans après son instauration officielle au Canada, la Journée nationale des peuples autochtones est l’occasion de reconnaître et de rendre hommage à l’histoire, à la diversité culturelle et aux contributions des Premières Nations, des Inuit et des Métis à la société canadienne.
Photo : Radio-Canada / Ismaël Houdassine
Nakuset le reconnaît sans détour, l’heure est à la relève. Elle note l’importance de former la prochaine génération aux questions sociales. Moi, je vieillis. Regardez aujourd’hui, je ne peux même plus monter sur scène à cause de mes genoux, alors les techniciens ont baissé les micros de la scène pour moi, confie-t-elle en riant. Mais plus sérieusement, il faut que d’autres prennent le relais.
Car ce n’est pas qu’une question d’âge, insiste-t-elle, mais de responsabilité collective. Beaucoup pensent que la réconciliation, c’est à nous, Autochtones, de la porter. Mais non, c’est censé être un effort partagé. Chaque institution doit faire sa part. Et les faits, dit-elle, parlent d’eux-mêmes.
La toute première recommandation de la commission vérité et réconciliation portait sur le système de protection de l’enfance. Elle n’a toujours pas été appliquée. Même chose avec la commission Viens au Québec,, lâche-t-elle amère.
Un tribunal et des projets ambitieux
Face à l’inaction qu’elle juge insupportable, Nakuset et ses alliés se tournent vers la justice internationale. En mai 2026, un tribunal citoyen — le Tribunal permanent des peuples (TPP) — se tiendra à Montréal, dans les locaux d’un studio d’art autochtone.
L’idée, c’est de présenter nos preuves à des juges venus d’Europe. On espère que le gouvernement canadien réagira en se disant enfin : "Ah, peut-être qu’on devrait appliquer ces recommandations".
Le projet est ambitieux. Cinq journées d’audiences, consacrées aux pensionnats, aux institutions, aux Églises. Et sur les murs, derrière les juges, on affichera des petites chaussures d’enfants. Une image forte, pour rappeler les vies volées, précise-t-elle.

C’est dans l’ouest du centre-ville – plus précisément au square Cabot – que le public trouvera le plus vaste éventail de musique autochtone à Montréal.
Photo : Radio-Canada / Ismaël Houdassine
En attendant, la directrice a les yeux rivés sur la scène. Le concert se déroule au square Cabot, lieu emblématique de l’itinérance autochtone à Montréal, que Nakuset connaît intimement. J’y mène des projets depuis 15 ans. On a eu des travailleurs de rue, puis des médiateurs. Aujourd’hui encore, deux de mes employés sont présents dans le parc.
Autour du square, les tours de condos de luxes ont remplacé l’ancien hôpital. Mais le préjugé sur les personnes marginalisées persiste. Peut-être qu’en voyant ces artistes aujourd’hui, certains réaliseront à quel point les Autochtones sont talentueux. Il faut changer le regard. Il y en a parmi nous qui sont professionnels, et ceux qui ne le sont pas encore, c’est à nous de les aider à briller.
Il reste que l’organisation d’un concert à l’occasion de la Journée nationale des peuples autochtones n’a jamais été une mince affaire, souligne-t-elle. À une époque, la directrice du Foyer pour femmes autochtones de Montréal recevait à peine 6000 ou 8000 $.
Je devais tout faire moi-même : louer une scène, trouver des techniciens pour le son, et il ne restait presque rien pour payer les artistes et je dirige un refuge. Ce n’est pas vraiment mon domaine.
Tout a changé lorsque POP Montréal s’est joint à l’événement, il y a six ans environ. Grâce à ce partenariat, les moyens ont grandi, tout comme l’ambition du spectacle.
Si vous regardez la programmation, presque aucun des artistes n’est local et tous sont autochtones. Nos danseurs de cerceaux [la famille Sinquah] viennent de Phoenix, en Arizona. Ce sont des champions du monde, ils remportent tous les prix partout où ils passent.
Il reste que le cœur du projet reste le même, celui d’offrir un moment de beauté et de dignité aux plus vulnérables. Le public ici, ce sont les personnes en situation d’itinérance. Elles n’auront jamais les moyens de se payer un billet pour un gros concert. Celui-ci est gratuit. Si vous restez pour le spectacle, vous verrez les expressions sur leurs visages : c’est de la joie pure, conclut Nakuset.


 2 weeks ago
8
2 weeks ago
8



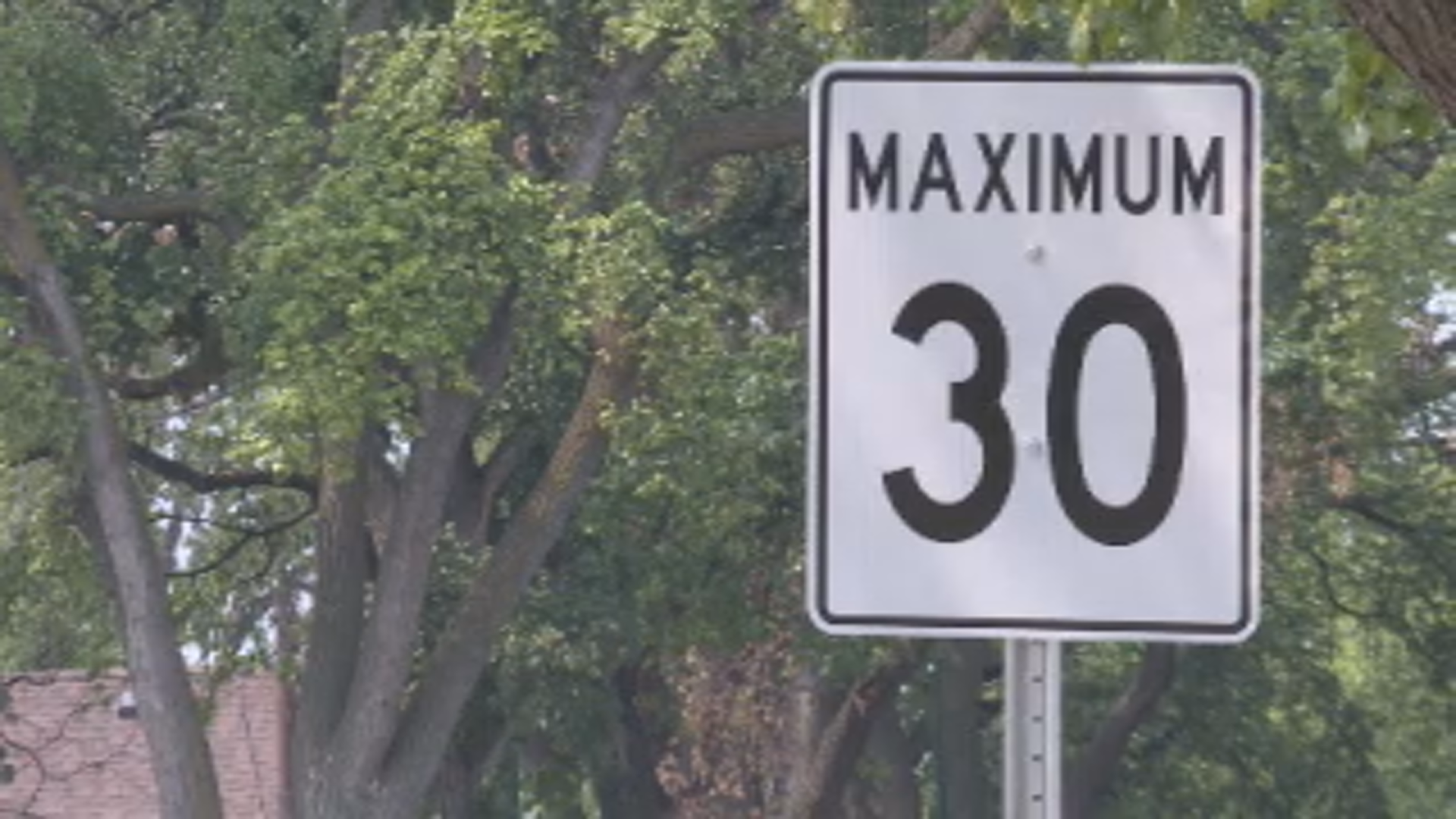
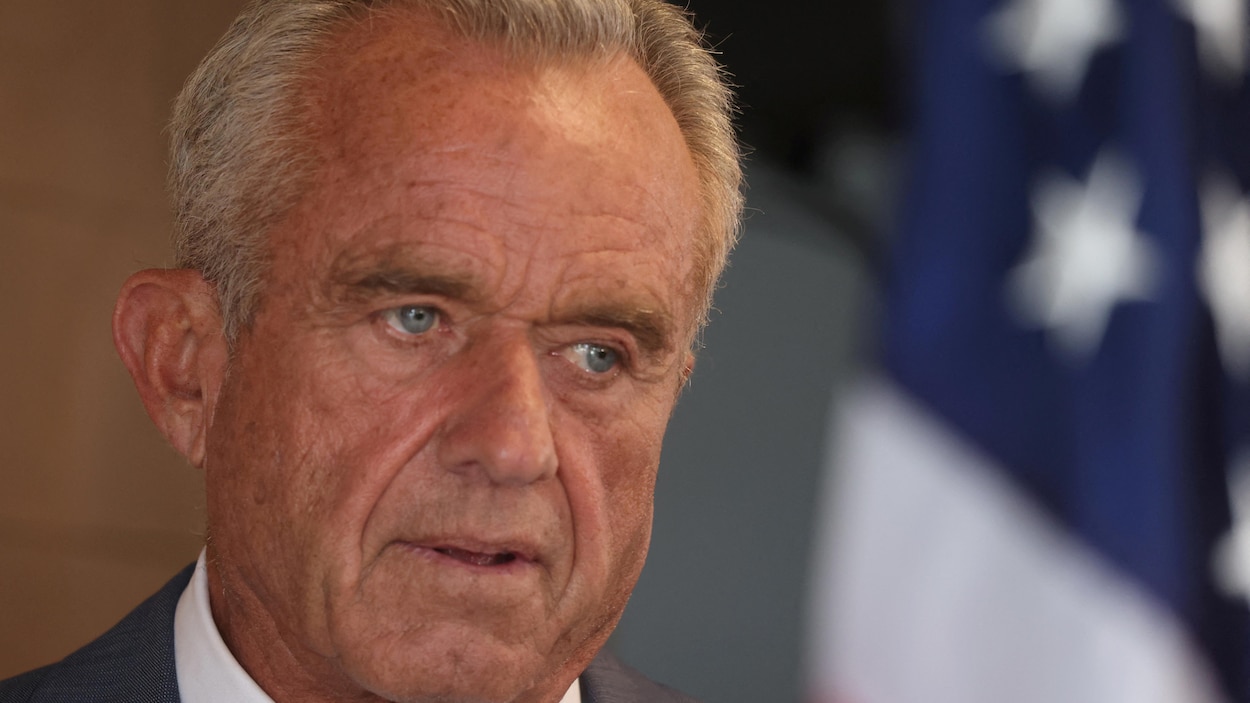





 English (US) ·
English (US) ·  French (CA) ·
French (CA) ·  French (FR) ·
French (FR) ·