PROTECT YOUR DNA WITH QUANTUM TECHNOLOGY
Orgo-Life the new way to the future Advertising by AdpathwayUn document inédit du ministère de l'Environnement du Québec, obtenu par Radio-Canada, dévoile à quel point l'usage de l'eau du secteur agricole est « très mal encadré » au point où « des municipalités sont en compétition avec des gros préleveurs agricoles et industriels » pour accéder à la ressource.
Selon un ancien haut fonctionnaire du ministère qui est toujours soumis à un devoir de réserve, ce document vise clairement à alerter les autorités du ministère sur la sévérité de la situation dans le sud et le centre du Québec.
Depuis cet été, des reportages de Radio-Canada ont documenté les manques d'eau dans certaines régions et les risques de conflits d'usages entre les différents préleveurs. Ce document vient valider ces préoccupations.
Selon nos sources, l'état de situation, réalisé fin 2024, a été commandé par des hauts responsables du ministère qui espéraient une prise de conscience du gouvernement au sujet des grandes quantités d'eau prélevées par des agriculteurs et du manque de surveillance.
L'image que j'utiliserais serait celle d'un pilote qui contacte la tour de contrôle en répétant trois fois le mot "Mayday"!

La rivière Yamaska, en zone agricole, est sous forte pression
Photo : Radio-Canada
Plusieurs régions au cœur des préoccupations
L'analyse se concentre sur les trois régions que nos sources identifient comme les plus problématiques pour la disponibilité de l'eau : la Montérégie, l'Estrie et le Centre-du-Québec.
On peut lire dans le document que depuis quelques années, plusieurs usagers (villes, municipalités, entreprises, institutions agriculteurs, etc.) du Centre-Sud du Québec ont eu des problèmes de pénuries d'eau.
Parmi les causes identifiées par le ministère, il y a le développement résidentiel, industriel et agricole excessif par rapport à la ressource disponible, mais aussi la diminution de la ressource (nappe moins productrice, surexploitation de la nappe ou des cours d'eau, prélèvements illégaux, etc.)
En Montérégie, des agriculteurs ont manqué d’eau, cet été, et certains ont dû abandonner l’irrigation de champs.
En Estrie, des villes comme Sutton ont dû faire venir de l’eau par camion afin d’approvisionner leurs réservoirs.
Dans le Centre-du-Québec, le développement de la production de canneberges est tellement fulgurant que le ministère craint que des rivières puissent être vidées.

Une cannebergière dans le Centre-du-Québec.
Photo : Radio-Canada
Un secteur agricole très mal encadré
Les fonctionnaires qui ont rédigé l'état de situation écrivent qu'une grande quantité de prélèvements agricoles ne sont pas autorisés.
De nouveaux puits, prises d'eau et bassins d'irrigation sont ajoutés sans autorisation.
Un tableau expose une série de problèmes, selon la Municipalité. Par exemple, à Saint-Constant, en Montérégie, on note des conflits d'usage entre les secteurs municipal, agricole et industriel pour l'eau souterraine.
Un producteur maraîcher prélève environ 29 millions de litres par jour sans autorisation, peut-on lire dans le document, toujours au sujet de Saint-Constant.
Il n'a pas été possible d'obtenir plus de détails sur ce cas et ni l'Union des producteurs agricoles (UPA) ni l'Association des producteurs maraîchers du Québec n'ont été en mesure de nous en dire davantage.
De son côté de Saint-Constant, la Ville a décliné notre demande d'entrevue. Une porte-parole a précisé par courriel que la Municipalité ne fait actuellement face à aucun conflit d’usage majeur lié à l’eau souterraine sur son territoire.
Des problèmes et des recommandations caviardés
Trois pages du document du ministère ont été complètement caviardées, surtout la partie qui détaille les problèmes au sein du ministère. Le ministère de l'Environnement a aussi caché les recommandations, à la fin du document qui fait un total de neuf pages.
Nous avons fait lire le document à Emmanuel Dubois, chercheur associé à la Chaire de recherche sur l’eau et la conservation du territoire de l'UQAM. Selon lui, il est très probable que la région du centre sud du Québec surexploite ses ressources en eau.
On apprend collectivement, un peu douloureusement, que l’eau n’est pas une ressource inépuisable, même ici au Québec.

Arrosage d'un champ de blé.
Photo : Getty Images
Un non conformité assumée
Les producteurs maraîchers, ils savent que la majorité d'entre eux ne sont pas conformes à la réglementation, admet Daniel Bernier, responsable des questions environnementales à l'Union des producteurs agricoles (UPA), en entrevue avec Radio-Canada.
Ils ont bien hâte de pouvoir s'y conformer, mais ils réclament des ajustements à la réglementation, explique-t-il, parce que là, actuellement, il y a tellement d'embûches.
Les producteurs se sont dit : "On va éviter la complexité et on se rendra conformes quand tout ça sera plus clair."
Le représentant de l'UPA explique que pour obtenir une autorisation de prélèvement d'eau, les producteurs agricoles doivent passer par un processus laborieux et coûteux.
On est des exemples de fermes qui, après plus de cinq ans de démarches, ne parvenaient toujours pas à obtenir leur autorisation, explique Daniel Bernier. Il évoque aussi des frais importants d'études et de consultants, parfois de dizaines de milliers de dollars pour répondre aux exigences du ministère.

Daniel Bernier, responsable des questions environnementales à l'Union des producteurs agricoles. (Photo d'archives).
Photo : UPA
Au Québec, tout prélèvement d'eau de plus de 75 000 litres par jour doit être autorisé par le ministère de l'Environnement.
À la demande de l'UPA, une exemption a été accordée aux agriculteurs jusqu'en 2024 et celle-ci a été prolongée jusqu'en 2029, toujours à la demande du milieu agricole.
Toutefois, pour en bénéficier, le producteur agricole ne doit pas avoir augmenté la quantité d'eau prélevée par rapport à l'année 2014. Il ne doit pas non plus avoir modifié ou déplacé ses sites de prélèvements.
Je n'exclus pas qu'il y ait des producteurs qui aient augmenté leur capacité de pompage sans aller chercher d'autorisation.
Souvent, c'est dans l'empressement, que les producteurs agissent, explique M. Bernier. Ils ont vécu une situation de pénurie d'eau, ils ont perdu une récolte... et là, ils sont pressés de modifier leur installation pour éviter que la situation se répète.
Malgré tout, l'UPA assure très bien comprendre la responsabilité du ministère de s'assurer qu'il y a assez d'eau pour tous les usages.

Bernard Drainville est le ministre de l'Environnement du Québec. (Photo d'archives)
Photo : Radio-Canada / Sylvain Roy Roussel
Le ministère en action pour corriger la situation
Nous avons demandé au ministère de l'Environnement quelles mesures ont été prises à la suite des constats évoqués dans le document.
Par courriel, la porte-parole régionale Ghizlane Behdaoui écrit que le ministère dispose d’outils et de moyens pour réagir lorsque sont portés à son attention des enjeux relatifs à la disponibilité de l’eau.
Elle cite l'exemple du projet pilote mis en place cet automne, dans le Centre-du-Québec pour obliger les grands préleveurs d’eau (municipalités, industries, agriculteurs, terrains de golf, etc.) à réduire leur consommation lorsque les niveaux des rivières sont jugés trop bas.
Pour le secteur agricole, le ministère est en marche pour parfaire sa connaissance de la situation. Ainsi, une déclaration des prélèvements d’eau effectués en 2026 sera à transmettre au plus tard le 31 mars 2027.
Le ministère rappelle aussi qu'il a fixé, ce printemps, un nouvel ordre de priorité pour clarifier qui bénéficierait en priorité de l'eau si la ressource venait à être insuffisante pour tous les usages.
L'ordre de priorités instauré en avril 2025
Besoins de la population en matière de santé, de salubrité, de sécurité civile et d’alimentation en eau potable
Écosystèmes aquatiques
Agriculture et aquaculture
Industrie, production d’énergie, loisirs, tourisme, etc.
Pour le moment, jamais le Québec n'a eu à faire de choix entre les utilisateurs de l'eau, mais il s'y prépare.
Selon le chercheur Emmanuel Dubois, pour limiter ces situations insoutenables et protéger à la fois les activités économiques et les milieux de vie, il faut identifier les zones en surexploitation, comprendre les facteurs qui aggravent la situation et repérer les indicateurs environnementaux associés à cette surexploitation. Cela exige une vision globale des ressources en eau, souterraines comme de surface, qui sont aussi affectées par les changements climatiques.
Avec la collaboration de Marianne Dépelteau


.jpg) 7 hours ago
3
7 hours ago
3




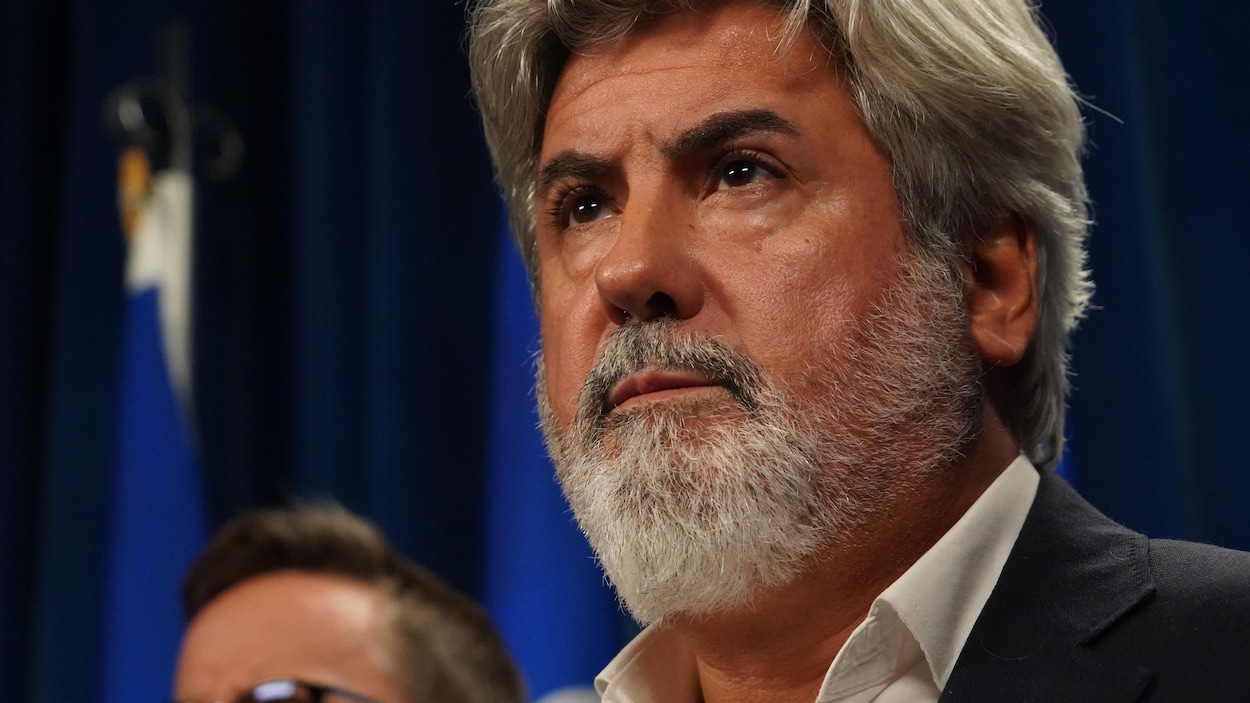
















 English (US) ·
English (US) ·  French (CA) ·
French (CA) ·  French (FR) ·
French (FR) ·